| Revolucion
|
|
Du printemps de Fidel à l'automne du patriarche
|
|
par Alexandre Adler
|
Batista parti, Cuba aurait pu hériter d'une démocratie. Les
folies de Castro et du Che en ont décidé autrement.
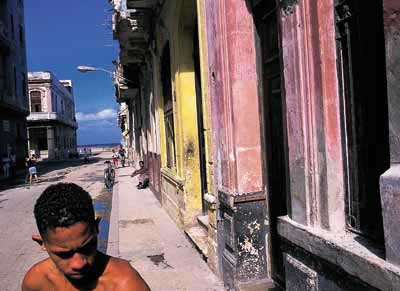
Dans
une rue du centre de La Havane. Comme presque partout dans la capitale,
on slalome entre gravats et nids de poule.
©
J.-P. Guilloteau
L'histoire des Antilles soviétiques
a commencé dans la liesse. Et sans le communisme. Dans les années 40
et 50, la grogne indépendantiste s'adosse au fantôme de José Marti -
abattu en 1895. C'est une mouvance jacobine et populiste, lyrique et égalitaire,
franc-maçonne et parfaitement démocratique. Ajoutez-y deux doigts de
poésie tropicale et une réelle lassitude envers le Yankee. Et voilà
le tableau. Porteur de cette vague: le Parti orthodoxe de Chibas, dont
Fidel Castro dirigera, à l'université, le Mouvement de jeunesse.
Pauvre Chibas, dont le désespoir et le suicide, en 1952, ouvrent la
voie à Castro. Peut-être aurait-il créé, s'il avait vécu, un régime
intermédiaire entre ceux du PRI, au Mexique, et de Getulio Vargas, au
Brésil; un régime biodégradable qui aurait, peu à peu, laissé place
à une démocratie véritable. Fidel choisira une autre voie: radicale,
dictatoriale, tournée vers l'Europe.
Fils d'un colon galicien venu sur le tard avec l'armée de l'Espagne
royale, élève des jésuites de Belen confits dans leur dévotion pour
la croisade de Franco, Castro appartient tout entier à l'Ancien Monde
de la Caraïbe; son ralliement au Parti orthodoxe et à la «cubanité»
libérale et panaméricaine ne pouvait être que de surface. Avant d'être
communiste, il a voulu, selon le mot de Brecht, «dissoudre le peuple».
Forcer les Cubains à devenir autre chose qu'eux-mêmes. A se
transcender dans une nouvelle humanité révolutionnaire. Avec des réminiscences
mussoliniennes: l'assèchement longtemps envisagé des immenses marais
Zapata, longs de 200 kilomètres, fleure bon ses marais Pontins, et ses
prêches intégristes, l'attente de l'homme nouveau chère à ses maîtres
jésuites.
La fête verbeuse et faussement allègre préparait le pire. Car il n'y
a nul complot soviétique dans le basculement communiste de la révolution
cubaine, mais la volonté ardente de deux hommes, Fidel Castro et
Ernesto «Che» Guevara. L'Amérique eisenhowérienne n'a guère
d'intentions hostiles à l'égard du nouveau régime. Le FBI est enchanté
de voir disparaître, avec Fulgencio Batista, un protectorat officieux
du syndicat du crime. Nelson Rockefeller, qui inspire alors la politique
latino-américaine des républicains, s'attend à une répétition des
nationalisations mexicaines opérées par Lazaro Cardenas en 1938, et se
montre prêt à discuter des indemnisations des sociétés américaines
lésées. L'idée dominante, c'était de laisser la révolution cubaine
rentrer dans son lit et de coopter habilement ses élites bourgeoises,
afin d'atteindre assez vite un profil d'équilibre de type mexicain:
verbalisme progressiste à l'exportation, alliance américaine solide en
profondeur, remise en ordre à l'intérieur. Les Etats-Unis ne
trouveront pas les interlocuteurs qu'ils recherchaient, ou plutôt en récupéreront
une pléthore, mais à Miami, où Castro les envoie se perdre délibérément
dans les traces du président de la République, Manuel Urrutia, représentant
traditionnel de l'orthodoxie libérale, bientôt contraint à l'exil
politique. Castro a déjà choisi. Il veut précipiter l'irréversible.
Imposer un choix socialiste original. Provoquer l'affrontement avec les
Etats-Unis. Eliminer ses contradicteurs.
Sans doute s'imagine-t-il que l'étincelle cubaine sera bientôt relayée
par une série de révolutions latino-américaines. Sans doute se
figure-t-il qu'en se jetant à la tête des dirigeants soviétiques il
forcera ces derniers à le prendre en charge. Lorsque Anastas Mikoïan,
alors l'âme damnée de Khrouchtchev, arrive en 1960 à La Havane, il
est à cent lieues d'imaginer qu'il va être l'objet d'une véritable
demande en mariage.
Certes, les Soviétiques ne sont pas des enfants. Ils ont nommé comme
ambassadeur un vétéran du KGB, Serge Koudriavtsev: cet artiste a démarré
sa carrière, dès les années 30, avec Kim Philby pendant la guerre
d'Espagne. Ils disposent, via les marxistes du Parti socialiste
populaire (PSP), de relais importants: Osvaldo Sanchez, qui réorganise
la police; Annibal Escalante, le chef de l'appareil spécial, formé
directement, à Moscou, par le KGB; et surtout un bon intellectuel
aristocratique, Carlo Rafael Rodriguez, qui n'a jamais cessé d'être
l'officier traitant de «M. Frère», Raul Castro. Ancien des Jeunesses
communistes, réintégré clandestinement au Parti en 1957, Raul est une
«tête faible» qui porte son fanatisme soviétophile en bandoulière.
Les Soviétiques compléteront le dispositif en mettant à disposition
de Raul - devenu très vite ministre de la Défense - une pléiade de
techniciens compétents et de gloires militaires authentiques, comme le
général tatar Pliyev, qui contrôlera les fusées et les troupes soviétiques
installées en 1962.
Reste que c'est Guevara, et personne d'autre, qui officialise le délire.
En s'adressant aux commandants, tel Huber Matos, qui récusent le
nouveau modèle collectiviste-autoritaire en rupture avec la filiation
libérale de la révolution, le Che leur lance au visage: «Le salut du
monde passe par ce que vous appelez le Rideau de fer!» C'est l'alliance
entre Guevara, Raul Castro et le PSP qui marginalise à toute vitesse
les courants démocratiques qui dominent dans les élites du Mouvement
du 26-Juillet - référence à l'attaque de la caserne Moncada, en 1953
- et du Directoire révolutionnaire issus du Parti orthodoxe. Pour une
fois, la révolution est confisquée non par des modérés, comme au
Mexique, mais par des jacobins caraïbes radicaux qui éliminent
brutalement la «Gironde» et, l'ayant expulsée à Miami, font rentrer
par la grande porte une Union soviétique qui n'en demandait pas tant.
Le décor est ainsi planté. La tragédie va suivre.
Eisenhower et Allen Dulles, patron de la CIA, suivaient avec une inquiétude
croissante le processus de radicalisation cubain. Mais le vieux chef des
armées américaines qu'était «Ike» était réticent à toute
intervention. Il laissera ce dossier brûlant, en janvier 1961, à son
successeur: John Fitz- gerald Kennedy. Ce jeune homme s'est imprudemment
engagé à combattre - partout - le communisme. Par ailleurs, il bénéficie
d'un large soutien des mafieux de Chicago et de New York - des amis de
son père - sérieusement lésés par les spoliations castristes.
La CIA pense donc pouvoir lui forcer la main en déclenchant à toute
allure un débarquement de supplétifs, inspiré de l'expédition
victorieuse organisée, en 1952, contre le régime un peu semblable du
colonel Arbenz, au Guatemala. Allen Dulles donne le feu vert à ses
hommes de Miami. Parmi eux, dit-on, figurait George Bush: les deux
bateaux principaux de l'expédition portent les noms de Barbara, comme
sa femme, et de Zapata, comme la société dont il est PDG. Tout ce beau
monde se doutait bien que le débarquement de la baie des Cochons (playa
Giron), en avril 1961, ne pouvait à lui seul renverser un régime
encore très populaire, mais ils espéraient créer un abcès qui
aurait, dans les heures suivantes, déclenché une intervention
militaire des Etats-Unis. C'est ce que Kennedy, à leur grande surprise,
va leur refuser avec rage. Entraînant une épuration sans précédent
de la CIA.
Pourtant, une guerre est bien déclarée entre Cuba et les Etats-Unis,
et la crise cubaine se mondialise. Jusqu'à présent, Castro avait tout
fait pour attirer les Soviétiques. A présent, la courroie de
transmission s'inverse: dans les codes du KGB, Cuba est rebaptisé
Avanpost, l'avant-poste du socialisme. Désormais, les questions
cubaines montent directement au Bureau politique, où Khrouchtchev, Mikoïan
et le président du KGB, Alexandre Chelepine, prennent seuls ce qu'il
est convenu d'appeler les «décisions fondamentales».
«Anadyr», le coup de poker
La décision fondamentale qui taraude Khrouchtchev est mirobolante. L'opération
«Anadyr» porte le nom de la péninsule la plus extrême de la Sibérie...
non loin de l'Alaska. Donc, du territoire américain. Elle est le coup
de poker le plus délirant de toute l'histoire soviétique, celui qui
rapprochera le monde d'une guerre nucléaire comme jamais. D'ailleurs,
Khrouchtchev paiera au prix fort son délire stratégique: tout juste
deux ans plus tard, en 1964, les néostaliniens seront de retour et
lui-même relégué à vie dans une datcha isolée, entouré de
jardiniers velus et hostiles.
Mais rendons justice à Castro: s'il est seul responsable de la présence
soviétique à Cuba, il n'a jamais demandé qu'on lui installe
clandestinement des missiles nucléaires à moyenne portée SS 4 et SS
5. Cela, c'est Khrouchtchev, et à la fureur du maréchal Malinovski, le
ministre de la Défense, qui sent bien le danger imminent. Pourquoi une
telle folie? La réponse tient en trois mots: Turquie, maréchaux,
Chine.
Les Américains ont en effet déployé des missiles à moyenne portée
en Turquie, à quelques encablures du territoire soviétique, et les
dirigeants soviétiques ne supportent guère un tel manque de politesse.
Les maréchaux, eux, sont très mécontents des réductions d'effectifs
opérées par Khrouchtchev dès 1957, lesquelles menacent de se
poursuivre. Le Premier secrétaire n'a-t-il pas déclaré urbi et orbi
qu'un missile à tête nucléaire valait bien une division blindée? Il
veut maintenant faire la preuve expérimentale de son théorème.
La Chine, enfin: nous sommes en 1962, au moment crucial où la polémique
avec Mao devient ouverte et explicite. N'est-il pas temps pour Moscou de
marquer son territoire et de montrer que, à Cuba, l'Union soviétique
est susceptible de défier les Américains comme les staliniens chinois,
si prompts à la critiquer, en sont bien incapables? La démonstration
est d'autant mieux venue que Che Guevara, à la tête de l'économie,
est en grande sympathie avec la Chine.
Dans ce contexte, à Cuba, nos Pieds nickelés apparaissent dans un
nouveau rôle: agents passifs d'une crise qui les dépasse très
largement, Castro, Guevara et Cie vont néanmoins largement la
compliquer par un mélange très franquiste de bêtise, d'arrogance et
d'irresponsabilité. Fidel va s'opposer aux inspections des sites de
missiles dans l'île, que les Soviétiques veulent accepter pour sortir
de l'impasse. Après avoir vu Castro, hystériquement hostile à toute
présence d'observateurs yankees chez lui, Mikoïan parlera dans son
rapport d'une «émotivité incontrôlable». Il est vrai que
Khrouchtchev a déjà dans les mains la lettre écrite par Castro dans
le propre bureau du nouvel ambassadeur, le général du KGB Alexeïev. Y
figure la phrase suivante: «Si les Américains vont jusqu'à mettre en
œuvre l'acte brutal d'envahir Cuba, ce sera le moment opportun pour éliminer
un tel danger pour toujours à travers un acte de légitime défense, si
dure et terrible que puisse sembler une telle solution.» Alexeïev n'en
croit pas ses yeux: Castro propose à Khrouchtchev de faire usage de
l'arme nucléaire. Rien que ça.
Après la crise, toute l'équipe militaire soviétique se retrouvera au
ministère cubain de la Défense, où l'on fête la promesse que les Américains
n'attaqueront pas. Ambiance tendue. Pas un Russe ne porte un toast à
Fidel. Un Cubain ivre, le colonel Rodriguez, vieil agent du KGB puis du
GRU, voudra lever son verre en l'honneur «de Fidel et de Staline». En
apprenant ça, à Moscou, Khrouchtchev n'aura qu'une envie: étrangler
ce Rodriguez.
La crise de Cuba fait deux vainqueurs: Kennedy, qui a su montrer sa
fermeté et obtenir le départ des missiles; Castro, qui a sauvé sa tête,
son régime, son île. Mais elle laisse une victime sur le carreau:
Nikita Khrouchtchev, et avec lui sa théorie du tout- nucléaire. Désormais,
Castro s'émancipe de la tutelle soviétique et tente de jouer sa propre
partition dans les affaires communistes mondiales. Guevara atteint alors
sa brève apogée politique.
L'archange de la révolution, le Saint-Just de la Caraïbe mérite un
autre regard que le dolorisme extatique qui accompagne aujourd'hui
toutes les références à sa carrière. Argentin, porteño - ayant vécu
toute sa jeunesse à Buenos Aires, bien qu'étant né à Rosario -
Guevara a reçu son bagage marxiste de l'avocat trotskiste Silvio
Frondizi, frère du président radical Arturo Frondizi, ami du futur président
chilien Allende. Fruste et ardent, il fera de la Révolution permanente,
de Trotski, un projet de révolution continentale latino-américaine à
la Garibaldi. Et de Cuba, si proche encore des Etats-Unis et de
l'Espagne, le Piémont de cette nouvelle construction géopolitique. Il
apporte sans nul doute un vent d'Histoire et d'ampleur métaphysique au
provincialisme sportif des Cubains. Mais il introduit d'emblée un
sectarisme terrible au sein d'une révolution plutôt bon enfant et libérale.
Nommé ministre de l'Industrie, il applique sans fléchir ses idées très
particulières en matière économique, mélange d'analphabétisme
patagonien, de vagues remémorations des prêches de Silvio Frondizi et
des sagaces conseils rousseauistes de ses associés trotskistes,
notamment le Belge Ernest Mandel. Après avoir détruit les embryons
prometteurs d'industrie cubaine qui demeuraient, le Che n'a plus qu'à
s'en prendre au principe de la circulation monétaire elle-même. A
l'aide généreuse de l'Union soviétique et du Comecon. Aux experts étrangers,
comme le Tchèque Frantisek Kriegel ou le Français Charles Bettelheim,
qu'il fait expulser. A ses critiques communistes orthodoxes, enfin, dont
il obtient la mise au pas, avec l'interdiction de leur revue, Cuba
socialista, qui défendait encore quelques positions de bon sens dans
cet océan de borborygmes verbeux.
Rien n'entame l'utopie cubaine
Grandeur de Guevara: alors que Castro intensifie le tournant gauchiste
du régime avec la Tricontinentale, qui se veut une nouvelle
Internationale communiste du Sud - sans Pékin ni Moscou - l'éphémère
dictateur de l'économie tombe dans la prostration. Il oublie de se réjouir
de la répression qui s'abat sur ses anciens amis prosoviétiques arrêtés
- et torturés sans interruption de 1964 à 1968. Il rêve d'aller voir
ailleurs. Il mourra comme il a vécu, stupide, brutal et résolu, entraînant
dans sa faillite une génération brûlée jusqu'à l'os d'intellectuels
et de militants latino-américains qui lui étaient, sur tous les plans,
très supérieurs.
Après l'échec de la baie des Cochons, la CIA élabore - et Kennedy est
au parfum - des plans d'assassinat de Castro et d'autres dirigeants. Des
attaques continuelles sont menées en mer; des simulations de guerre
bactériologique lancées à partir de l'enclave de Guantanamo. Parfois,
on atteint au grotesque de Hellzapoppin: la CIA envisage, en cas de mort
de l'astronaute John Glenn, en 1962, dans sa capsule Mercury, de faire
porter aux Cubains la responsabilité d'un hypothétique sabotage. Mais
ni la bêtise guévariste ni la cruauté imbécile des as de Langley ne
viennent à bout de l'utopie cubaine. Les années 70 verront en effet
s'esquisser une sorte d'apaisement réciproque. L'Amérique a perdu son
innocence meurtrière au Vietnam. Bientôt, elle fera le procès de sa
chère CIA: le sénateur Church, au lendemain du Watergate, brandira
l'arbalète à flèches empoisonnées «qui devaient tuer Castro». La révolution,
elle, a perdu de son dynamisme aveugle après l'échec de la «Grande
Zafra»: tout pour le sucre! Avec un naufrage économique total à la
clef. Fidel Castro se rappelle alors, en catimini, au bon souvenir de
ses protecteurs soviétiques, qui, malgré leur irritation envers les
barbudos, n'ont jamais été bien loin. Comme le dit si justement Hegel,
la vérité est à la fin: cette révolution cubaine qui avait tant de
mal à se conjoindre à une Union soviétique hésitante mais
antistalinienne, celle de Khrouchtchev, va trouver son moment d'harmonie
avec la contre-révolution brejnévienne, qui la subventionne à fonds
perdus.
Un Empire soviétique de plus en plus crispé dans sa posture
militariste fait de Castro un paladin pittoresque et chamarré du régime,
une sorte de maréchal tropicalisé, de Toussaint Louverture enfin
compris des Bonaparte vieillissants du Kremlin. Les Antilles soviétiques
prennent de l'ampleur à mesure que des générations de jeunes cadres
sont formés à Moscou, à Prague ou à Berlin-Est, que le parti
maritime et colonial de l'amiral Gorchkov invente le tirailleur cubain,
increvable et rustique, pour quadriller l'Afrique, de Luanda à Asmara.
De nouvelles perles éphémères s'ajoutent même peu à peu à la
couronne, avec le Nicaragua, la Grenade, Suriname. Mais, surtout, la
normalisation culturelle s'impose: enseignement du russe, uniformes soviétiques
et pas de l'oie de Souvorov - Fidel adoptant la tenue de maréchal qui
lui sied si bien - sport de masse qui triomphe aux Jeux olympiques,
pionniers en foulard. Et la lointaine Caraïbe devient une terre de
tourisme paradisiaque pour officiers du KGB. Pourtant, à cette apogée
illusoire devait succéder le moment de la négation de la négation:
Gorbatchev - en réalité, déjà Andropov avant lui - sonne la fin de
la récréation. De nouveau, Castro doit se plaindre de Moscou. Mais,
cette fois-ci, il a créé un embryon de société soviétique qui, lui
aussi, aspire à la perestroïka sans trop oser le dire. Ou parfois en
le disant trop clairement, notamment au ministère très «andropovien»
de l'Intérieur et à la tête de l'armée d'Angola, où se distinguera
le populaire général Ochoa. A cela Fidel nous donnera, au sommet de la
quête de la liberté au XXe siècle, en l'an de grâce 1989, sa propre
réponse, cohérente avec toute sa sinistre carrière: un procès à la
Toukhatchevski - maréchal de l'Armée rouge «jugé» en 37 et exécuté
par Staline - jeté à la face ébahie d'un camp socialiste qui n'est
plus. La tête d'Ochoa tombe aux pieds de Gorbatchev.
Aujourd'hui, le patriarche a ses compensations: une Europe frivole
l'adule à nouveau. Fraga Iribarne, l'exécuteur testamentaire de son
cousin Franco, lui a réservé une maison en Galice; Gorbatchev est anéanti;
et Mas Canosa, son rival de Miami qui finançait Eltsine depuis 1988 aux
fins de débrancher Cuba de la Russie, vient de mourir sans avoir revu
sa terre natale. Garcia Marquez continue de le louanger, et le souvenir
des si nombreux suicides autour de lui - le président Oswald Dorticos,
en 1976, la pasionaria de la révolution Haydée Santa Maria, entre
autres - n'empêche nullement son excellente digestion.
L'Amérique latine est depuis deux siècles pleine de mouvements
disparates d'un passé révolu de l'Europe, qui se survit, mangé par
l'exubérance de la forêt environnante: officiers brésiliens disciples
d'Auguste Comte qui croient en la divinité de Clotilde de Vaux,
lacaniens argentins, althussériens péruviens ou mexicains qui portent
cagoule en plein été. Fidel Castro a cru, comme son père, à
l'Espagne, à l'Europe, au catholicisme de la Contre-Réforme, à
Brejnev, à Franco, à la dictature. Peut-être était-ce la ruse de la
raison qui, une fois de plus, s'emparait de l'Histoire pour convertir
par écœurement à la démocratie nord-américaine toute la Caraïbe,
le Mexique et les pays bolivariens. Qui seront submergés quand le
verrou cubain, épuisé et limé par les passions tristes de son éternel
tyran, aura cédé sous le poids de la mer et des ans.
Article
paru dans l'Express du 18/12/1997
|